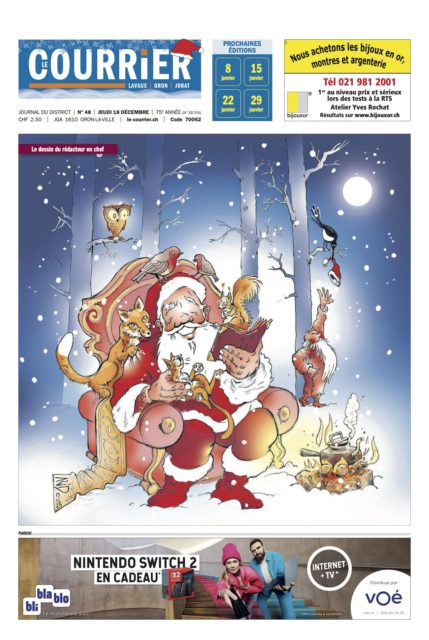La petite histoire des mots
Quolibet

Georges Pop | Un grand quotidien romand a titré le semaine dernière : « Un déluge de quolibets s’abat sur Trump, malade du Covid », allusion aux plaisanteries, parfois féroces, que la maladie du tonitruant et imprudent président américain a inspiré à nombre de ceux qui ne l’aiment pas, notamment sur les réseaux sociaux. « Quolibet » est un mot bien étrange pour désigner un propos moqueur, parfois vulgaire, à l’encontre d’une personne. De nos jours, on utilise plus volontiers des termes synonymes comme raillerie, moquerie, voire lazzi, un terme italien qui veut dire « mot d’esprit », et qui fut emprunté à la comédie italienne. Le mot « quolibet » est de nos jours le plus souvent utilisé au pluriel. Il est issu des deux mots latin « quod libet » qui signifient « ce qui (te) plait ». Au Moyen-Âge, dans le latin scolastique utilisé dans les universités, « quolibet » désignait un débat ou une discussion libre sur un sujet non préparé, choisi par l’assistance, par opposition à un cours préparé, imposé par les professeurs. On parlait alors de « disputationes de quolibet » ou de « disputationes de quodlibet », les deux orthographes étant alors admises, C’est, semble-t-il, à partir du XVIe siècle que le terme commença, par extension, à prendre le sens de « plaisanterie ». Comment en est-t-on arrivé là ? En ce temps-là, « quodlibet » désignait aussi, dans le domaine musical, un assemblage libre et humoristique de mélodies et de textes, souvent empruntés à la littérature. Deux siècles plus tard, le compositeur allemand Johann Friedrich Reichardt se distingua même dans un genre musical appelé « musichalisches Quodlibet », autrement dit « quolibet musical ». Si l’on en croit le compositeur, musicologue et théologien alsacien Jean-Georges Kastner, qui vécut au XIXe siècle, le passage progressif de sens de « quodlibet » à « quolibet » serait le résultat des beuveries des étudiants allemands, coutumières dans les universités germaniques, où les fêtards chantaient à tour de rôle, et en toute liberté, des airs drôles, moqueurs, voire injurieux. Le français a fini par adopter le mot dans le sens que nous lui connaissons désormais. Il est intéressant de noter, que les termes « quodlibétaire », et « quodlibétique » aujourd’hui tombés en désuétude, qualifiaient encore, il n’y a pas si longtemps dans le monde universitaire, des thèses dont le sujet avait été librement choisi par les étudiants. En guise de conclusion, relevons encore que le grand Charles Aznavour, dans sa très belle chanson « Comme ils disent », écrite en 1972, sur le thème de l’homosexualité, sujet qui constituait encore un tabou, utilisa à la fois les mots « lazzi » et « quolibets ». Voici le passage en question : « Moi, les lazzis, les quolibets / Me laissent froid puisque c’est vrai / Je suis un homo / Comme ils disent ». La chanson connut un immense succès : le 45 tours du titre se vendit à plus de 150’000 exemplaires. Charles Aznavour est mort le 1er octobre 2018. Sa chanson « Comme ils disent » reste une de celles que l’on entend, non sans émotion, le plus régulièrement, sur bon nombre de chaînes musicales francophones.