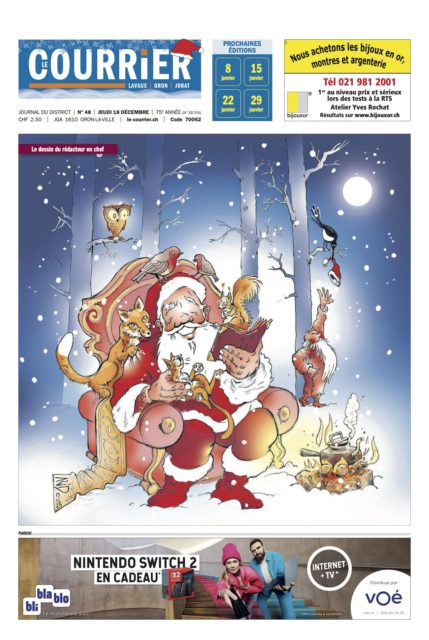Henri Manguin, le Fauve qui laissait éclater les couleurs
A la Fondation de l’Hermitage, Lausanne, jusqu’au 28 octobre
Pierre Jeanneret | Henri Manguin (1874-1949) passe parfois pour un « second couteau » parmi les Fauves. Son nom est un peu éclipsé par ceux de Matisse, Braque, Marquet, Dufy, Derain ou encore Vlaminck. Réputation injuste. Le visiteur de la remarquable exposition de l’Hermitage s’en convaincra. On en sort littéralement ravi. Manguin a très vite adhéré au Fauvisme. Rappelons que ce mouvement pictural assez éphémère (1905-1909), que l’on considère souvent comme la première révolution artistique du 20e siècle, a rassemblé des artistes voulant exalter la couleur pure. La force explosive de celle-ci a fait scandale au Salon d’automne. C’est de manière péjorative qu’un critique a parlé de «Fauves» (sortant donc du «bon goût») et ce terme est resté.
Les débuts
Une première salle permet de suivre les débuts de Manguin. Déjà dans La petite Italienne de 1903, on sent son amour des couleurs vives. Plus tard, avec son adhésion au Fauvisme, il laissera éclater celles-ci: des rouges, des verts crus, des mauves et surtout des violets – sa couleur préférée – en privilégiant les dissonances. Manguin a peint des paysages de Saint-Tropez, alors vierge de touristes. Le Midi avec les couleurs éclatantes de ses rochers rouges, avec le vert des pins, le bleu intense de la Méditerranée et celui du ciel, ne pouvait que plaire à ces peintres souvent issus du Nord de la France et habitués à des tons plus pâles, des ciels plus brumeux. L’artiste a aussi été le peintre de la femme, souvent représentée couchée sur une chaise longue, au repos, ou nue et alanguie. Guillaume Apollinaire appelait Manguin « le peintre voluptueux ». Son épouse Jeanne fut presque son unique modèle. Le deuxième étage est consacré à ses natures mortes. On y sent la forte influence de Cézanne. Mais chez Manguin, les couleurs sont plus crues. On en a un admirable exemple avec Fruits dans un plat rond (1909). Remarquons aussi que l’artiste, à l’instar de son compagnon Matisse, aimait représenter les tentures, les tapis aux motifs géométriques. Ce goût est attesté par le célèbre mécène Hans R. Hahnloser, qui accueillit Manguin dans sa villa Flora à Winterthour. La volupté chez Manguin est donc aussi dans son traitement des choses inanimées. On admirera particulièrement la toile représentant Jeanne devant une grande nature morte de fruits… que l’on a presque envie de manger. Ce qui rattache l’artiste à la grande tradition des peintres hollandais voulant rivaliser avec le réel. On pourra passer plus rapidement sur les oeuvres exposées au sous-sol. Il faut malheureusement reconnaître que les tableaux postérieurs à la grande époque fauve témoignent de moins de force créatrice. Sur le plan artistique, Henri Manguin semble un peu se survivre à lui-même. Le visiteur bénéficie gratuitement d’un audioguide. Où il entendra notamment les commentaires, tant picturaux qu’anecdotiques, de Jean-Pierre Manguin, le petit-fils de l’artiste, responsable de ses archives. Et s’il en a encore le courage au terme de cette très riche exposition, il pourra admirer un choix de tableaux de la collection de l’Hermitage, avec notamment des toiles de Félix Vallotton, Suzanne Valadon (la mère d’Utrillo) et Albert Marquet, trois artistes qui furent proches de Manguin.
«Manguin. La volupté de la couleur», Fondation de l’Hermitage, Lausanne, jusqu’au 28 octobre.

La sieste ou Le rocking chair, Jeanne 1905 – Huile sur toile, 89 x 117 cm – Berne, Hahnloser / Jaeggli Stiftung, Kunstmuseum