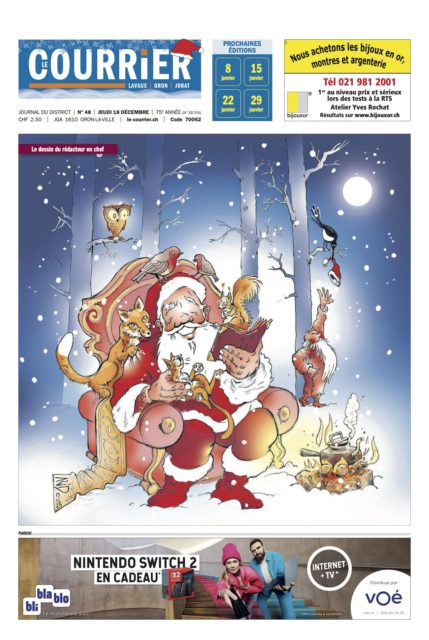La petite histoire des mots
Crèche

De nombreux Suisses, même non croyants, restent attachés à la tradition de la crèche de Noël, qui reproduit la scène de la Nativité. D’après l’Evangile selon saint Luc, troisième des quatre Evangiles canonique, le divin enfant serait bien né dans une étable de Bethléem, Joseph et Marie, ses parents, n’ayant pas trouvé un autre espace pour se loger. La basilique de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de la naissance de Jésus, a été érigée au IVe siècle par l’empereur Constantin. Elle est l’une des plus vieilles églises du monde.
Le mot « crèche », attesté en français, sous la forme « grèche » dès la fin du Moyen-Âge, désignait initialement une mangeoire pour les moutons ou les bœufs. Il est d’origine germanique, issu du terme « krippia », devenu « cripia » en latin. Dans la langue des Francs, qui avait conquis la Gaule, « krippia » désignait une auge. Ce n’est que vers la fin du XVIIIe siècle que « crèche » devint synonyme de « couche garnie d’une paillasse », d’ « asile pour nouveau-nés abandonnés », ancêtre de nos crèches actuelles, puis de « représentation de l’étable de la Nativité », quelques décennies plus tard.
La première crèche vivante fut créée au XIIIe siècle par Saint François d’Assise, fondateur de l’ordre des Frères mineurs. A son retour d’un pèlerinage en Terre Sainte, où il visita Bethléem, il eut l’idée de reproduire en grandeur nature une crèche, afin de raconter la Nativité aux habitants de Greccio, dans le centre de l’Italie. Dans la nuit de Noël de l’an 1223, la crèche prit vie sur le parvis de l’église du village, avec la participation des habitants. Cette pratique se répandit très vite dans toute la Péninsule, puis en Provence, grâce aux disciples de François.
C’est peut-être à Naples que furent imaginées les premières crèches constituées de figurines en bois. A la fin du XVIe siècle, les Jésuites, conscients du pouvoir de la célébration de la Nativité, multiplièrent dans toute la chrétienté les crèches en modèle réduit, s’en servant de catéchèse dans le cadre de la Contre-Réforme. Pendant le Révolution française, les crèches ayant été bannies des espaces publiques, elles se multiplièrent dans les familles soucieuses de célébrer Noël. C’est à partir de ce moment qu’on vit apparaître des santons de petites tailles. La première foire aux santons se déroula dans la ville de Marseille, en décembre 1803.
Les onze santons essentiels à la composition d’une belle crèche de Noël sont : l’enfant Jésus, Marie, Joseph, les trois rois mages, l’ange Gabriel, le berger, l’âne, le bœuf et l’agneau. Tous les santons présents dans une crèche doivent donner l’impression de s’avancer vers Jésus. Ils ne doivent par conséquent pas lui tourner le dos. Pour le reste, chacun est libre de les disposer à sa guise ou d’en ajouter de nouveaux.
Ah ! Ceci encore : au début du XXe siècle, l’argot s’empara du mot « crèche » pour désigner une chambre, ou un lieu d’habitation. Et le verbe « crécher » devint synonyme d’habiter.