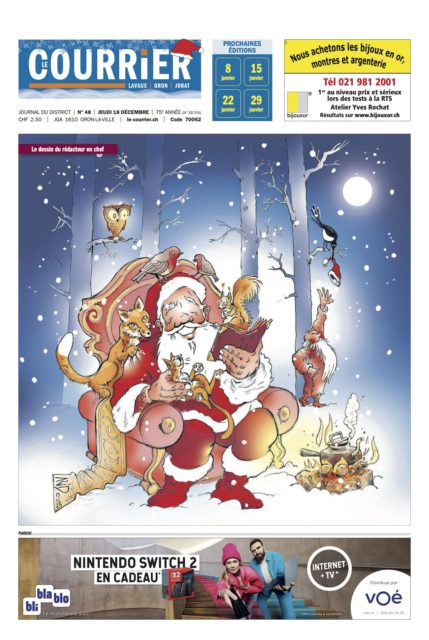La petite histoire des mots
Bourse

Une enquête de 24Heures et de la Tribune de Genève nous l’a appris la semaine dernière : un Suisse sur quatre boursicote, en faisant de petites opérations financières sur les marchés, dans l’espoir de mettre du beurre dans ses épinards. Le chiffre est loin d’être négligeable, même si nos compatriotes sont encore peu nombreux à « jouer en bourse », par rapport, par exemple, aux Américains qui sont un sur deux à gérer un portefeuille, plus ou moins volumineux, de titres financiers.
Pour désigner le petit sac destiné à contenir des pièces de monnaie, ou l’aide financière accordée à un universitaire pour la durée de ses études, le mot « bourse » nous vient du latin « bursa » qui veut dire « cuir », lui-même emprunté à un terme de grec ancien, de prononciation assez voisine, qui signifie « peau d’animal ». En français, ce mot est attesté sous la forme « borse » ou « bource », dès le XIIe siècle. Cependant, contrairement aux apparences, le terme « Bourse » (souvent écrit avec un « B » majuscule) a une origine très différente et bien plus singulière, lorsqu’il définit un marché financier.
Ce mot est né à Bruges, en Flandre, dont le port maritime était, au Moyen-Âge, un centre commercial et financier de premier plan. Les changeurs de devises et de titres avaient l’habitude de s’y retrouver pour faire des affaires. Une place située devant un hôtel bâti ou tenu, selon les versions, par les « Beurse », membres de la famille Van der Borse, devint leur principal lieu de rendez-vous. Le nom de cette famille, dont les armoiries affichaient trois bourses d’argent, finit par désigner l’endroit, puis la place elle-même. On se rendait « Ter Beurse », autrement dit « vers chez les Beurse » pour prendre connaissance des taux de change, vendre et acheter.
Cette place étant fréquentée par des commerçants et des spéculateurs venus d’un peu partout, le patronyme de cette noble famille flamande devint progressivement un nom commun qui, dans toute l’Europe, finit par désigner les lieux d’affaires et les places de marché : « Bourse » en français, à partir du milieu du XVe siècle, « Börse » en allemand, « Borsa » en italien, « Börs » en suédois, et même « Burse » en vieil anglais, avant que le déclin de Bruges, conséquence de l’ensablement de son port, et la montée en puissance de Londres comme place financière, ne conduisent à l’adoption du terme « (Stock-) Exchange », dans la langue de Shakespeare.
En guise de conclusion, ce petit conseil gracieusement offert aux boursicoteurs par le milliardaire américain d’origine hongroise George Soros. L’homme est devenu célèbre dans le monde entier pour avoir spéculé contre la livre sterling en 1992, gagnant près d’un milliard de dollars en une demi-journée. Il a déclaré : « Si pour vous investir est un plaisir, si vous vous amusez, alors vous ne gagnerez probablement pas d’argent. Un bon investissement est forcément ennuyeux ! »