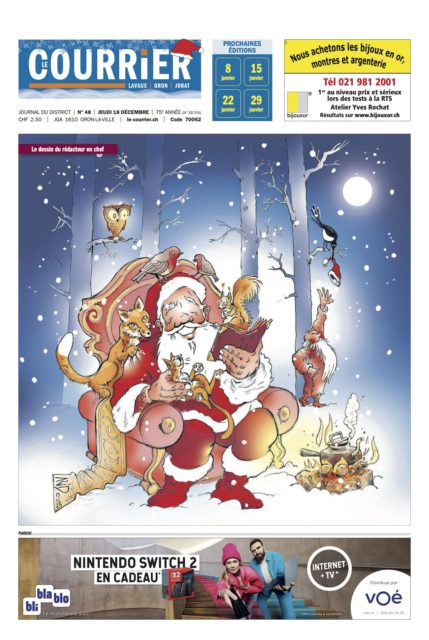La petite histoire des mots – Hypocrite
La chronique de Georges Pop

Georges Pop | Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, la presse et les dirigeants, occidentaux notamment, n’ont eu de cesse de dénoncer l’hypocrisie du président Vladimir Poutine et de ses pairs qui persistent à prétendre, en dépit des évidences, que leur guerre esta une opération humanitaire qui épargne les populations civiles.
Le mot « hypocrite » désigne de nos jours une personne fourbe et sournoise, qui dissimule ses véritables sentiments et affecte un air de vertu. Ce mot nous vient du grec « hypocritès » qui, dans l’Antiquité, désignait des acteurs de théâtre. Ces « hypocrites » jouaient un rôle et utilisaient un masque pour incarner des héros de la mythologie ou de simples mortels. L’hypocrisie (hypokrisis) connotait alors l’art de déclamer ou de plaider en adoptant une expression et une gestuelle empruntées au monde de la tragédie ou de la comédie, dont le monde grec était très friand. Devenu « hypocrita » en latin, ce terme continua à désigner un acteur ou un mime, mais acquit progressivement une charge péjorative pour caractériser un individu faussement vertueux. Dans la littérature française, « ipocrite » est avéré dès le XIIe siècle, sous la plume du poète Chrétien de Troyes, considéré comme l’un des premiers auteurs de romans de chevalerie. Loin de sa définition antique, l’hypocrisie définissait alors le péché qui consiste à faire semblant d’être bon.
La graphie actuelle fit, quant à elle, son apparition trois siècles plus tard. Dès le XVIIIe siècle, l’hypocrisie prit sa définition contemporaine : « le caractère de ce qui manque de sincérité », par exemple pour désigner l’incontinence et la lubricité de certains homme d’Eglise. De nos jours, dans un langage trivial, un hypocrite est souvent qualifier de « faux-cul » ou de « faux-derche ». Cette expression imagée nous vient de l’époque où le « faux-cul » était un rembourrage que les femmes mettaient sous leur robe pour donner l’illusion d’un beau fessier. Les élégantes qui se pâmaient à la cour du roi Louis XIV arboraient fièrement cet artifice postérieur qui fut attribué… à leur hypocrisie.
Mais revenons aux « hypocrites » de l’Antiquité qui jouaient dans des comédies et des tragédies. Il est intéressant de noter que, étymologiquement, « tragédie » veut dire « le chant du bouc ». Curieux, n’est-ce pas ! Le fait est que ce substantif est issu des mots grec « trágos » qui signifie bouc, et « ôidê » qui veut dire « chant », d’où est issu, en français, le mot « ode » qui désigne un poème lyrique. Comment en est-on arrivé là ? Selon la théorie la plus communément admise, à l’époque archaïque, vers le VIIIe siècle av. J.-C., lors des fêtes consacrées au dieu Dionysos – le Bacchus des Romains – les Grecs sacrifiaient un bouc, animal emblématique de la divinité, alors qu’un chœur chantait une dithyrambe, autrement dit un hymne à la gloire de celui qui était adoré en sa qualité de protecteur de la vigne et du vin. Progressivement, cependant, une partie du chœur s’est détachée du groupe pour donner la réplique aux chanteurs. C’est ainsi que naquit le théâtre et la profession d’acteur. Du coup, ce « chant du bouc » (tragôidía) a donné son nom à une pièce de théâtre, caractérisée par la gravité de son langage ; puis, une fois sorti du monde du théâtre, a fini par désigner un évènement funeste. Dans ce sens antique, Poutine est donc bien l’hypocrite, autrement dit l’acteur, de la sidérante tragédie qui se joue sous nos yeux…