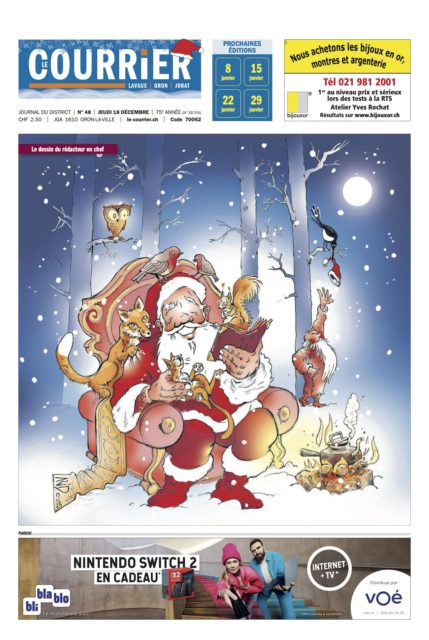Sauver les grands écrans
73e édition du Festival de Locarno

Charlyne Genoud | Le festival du film de Locarno organisé in extremis s’est fait tout petit cette année dans la ville tessinoise. Cette édition du festival ne saurait cependant être seulement définie comme réduite, car le festival n’a jamais été aussi international : le monde entier a pu y prendre part en ligne. Récit du festival « en présentiel ». A Locarno même, il faut tout de même avouer que l’absence s’est fait ressentir. D’abord celle du large public habituel, ensuite celle des cinéastes, et surtout celle du grand écran de la Piazza Grande. En même temps, cette édition collector et intimiste a octroyé à son public des moments d’émotion qui ont permis à tous de saisir l’impact de la pandémie sur l’industrie du cinéma. Ainsi, en voyant monter sur scène Lili Hinstin, Raphael Brunschwig et surtout Marco Solari, rescapé du navire Covid-19, on ne peut que repenser à la crise étrange et globale que l’on vient de tous partager séparés. Tout un paradoxe qui se retrouve à Locarno : le festival est ouvert à l’internationale, mais chacun reste dans son coin du monde. Une atmo-sphère très spéciale se développe alors dans le peu de salles de cinéma ouvertes cette année (le Palacinema, le GranRex et le Palavideo). Pour pallier à ce vide, le public a eu droit à des surprises réjouissantes. Ainsi, Lili Hinstin a su nous prendre de court avec ses « Secret screenings ». Sans même savoir le titre du film, les lumières s’éteignent et le public découvre la sélection de la directrice artistique. Le programme secret a fait varier les époques et les origines, passant de Roma es una citta aperta (Italie, 1945) à Nemesis (Suisse, 2020). Ce film conceptuel du Zurichois Thomas Imbach retrace les sept ans de construction d’une prison et d’un centre de police dans l’ancienne gare des marchandises de Zurich. Toutes les prises de vues sont faites depuis la fenêtre du réalisateur, et le son mêle des effets impressionnants de machineries à des témoignages de détenus. Un programme surprenant et intéressant, mais qui fut compliqué à aborder sans introduction… Dans la même selection, le public a pu découvrir Walden de Bojena Horackova, récupéré au festival de Cannes après son annulation. Puisqu’il était impossible pour la réalisatrice tchèque, exilée à Paris, de venir présenter la première mondiale de son long-métrage, Lili Hinstin a fait la surprise à son public de l’appeler depuis la scène du PalaVideo. Des petits évènements émouvants, on ne saurait expliquer pourquoi. Peut-être parce que Locarno, comme le dit Marco Solari « est par définition un lieu de rencontres » et que cette année, ce n’est pas ce qui définissait le festival. A deux mètres de distance, on demande moins à son voisin inconnu ce qu’il a pensé du film. Et puis, il fallait encore qu’il y ait un voisin deux chaises plus loin, car les salles n’étaient pas très remplies. Mais la rencontre, si elle est l’essence du festival, n’est pas sa mission profonde. Pour Lili Hinstin, le festival doit avant tout « défendre, soutenir et accompagner les artistes et leurs œuvres ». Le festival n’a donc pas du tout failli à son devoir. Intelligemment, les investissements ont été repensés: moins de prix pour des films qui ne seraient que peu vus en ce mois d’août post-confinement, mais plus de soutien à des films en difficulté suite à la crise. Une démarche pour soutenir les cinémas suisses a aussi été mise en place, le tout dans le cadre du projet The Films After Tomorrow. Le soutien aux jeunes cinéastes se retrouve aussi dans l’accent mis sur les Pardi di domani qui fût très suivi cette année tant en salles qu’en ligne.
Des rétrospectives pour voir l’avenir
Un autre moyen de voir le monde d’après demain a paradoxalement été trouvé par le choix d’une rétrospective. En effet, Through the Open Doors célébrait cette année les 18 ans de la section qui promeut le cinéma des pays émergeants. L’ouverture du programme avec Made in Bangladesh fut fort en émotion. Basé sur des faits réels, comme le précise Rubaiyat Hossain par téléphone avant la projection de son film, cette fiction thématise l’exploitation des femmes par l’industrie textile avec brio. La retrospective A Journey in the Festival’s History, a aussi permis au public de découvrir ou de redécouvrir les chefs-d’œuvres qui sont passés sur le grand écran tessinois. Choisis dans l’énorme catalogue des films des années précédentes du festival par les réalisateurs programmés pour The Films After Tomorrow, des films comme Der siebente Kontinent de Michael Haneke ou Stranger than Paradise de Jim Jarmusch ont su raviver la mémoire du passé… et en ce faisant, il semble qu’ils aient donné à tous confiance en l’avenir du festival! CG