Votations du 30 novembre
« Service citoyen » : un devoir ou une liberté ?
Le 30 novembre, les Suisses voteront sur l’initiative « Service citoyen ». Un texte qui propose de rendre obligatoire pour toutes et tous un service à la collectivité, qu’il soit militaire, civil, social ou environnemental. Entre ouverture et contrainte, deux voix locales s’expriment. D’un côté, Antoine Jaquenoud, membre du comité d’initiative, et de l’autre, Jean-Marc Chevallaz, président du Comité directeur de la Protection civile Lavaux-Oron. Retour sur cet échange.

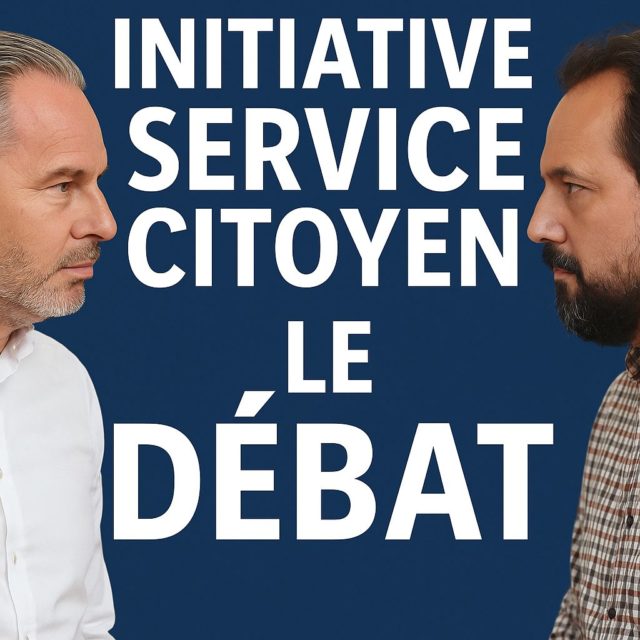
Tout citoyen suisse, quel que soit son genre ou son statut social, devrait pouvoir servir pour la collectivité », pose d’emblée Antoine Jaquenoud, porteur de l’initiative. Dans un débat vidéo, il explique que le texte rétablit une sorte de pacte civique « dans l’esprit de 1291 », où chacun contribue à la sécurité et à la solidarité du pays, que ce soit dans l’armée, la protection civile ou d’autres domaines d’intérêt public. « Le service citoyen universel permettrait de garantir les effectifs et de donner à chaque personne la liberté de choisir sa milice et la manière dont elle s’engage pour la collectivité. »
Face à lui, Jean-Marc Chevallaz, président du comité directeur de la Protection civile Lavaux-Oron, se montre plus réservé. Notre question était de comprendre pourquoi la Protection civile, au niveau national, recommande de rejeter cette initiative : « Les raisons sont multiples. D’abord, l’obligation généralisée, l’impact économique, mais surtout le risque d’une dilution des effectifs, car aujourd’hui, on parle déjà de l’armée, de la protection civile et du service civil. Si on y ajoute la santé, l’environnement et d’autres secteurs, on risque de disperser les forces au lieu de les renforcer ». A ses yeux, améliorer le système actuel passe par une meilleure clarté des rôles, plutôt que par la multiplication des missions.
Une milice à bout de souffle ?
Les deux hommes s’accordent pourtant sur un constat : le modèle actuel montre des signes d’essoufflement. Jean-Marc Chevallaz rappelle que les réformes récentes ont déjà réduit la durée d’engagement et l’âge limite des astreints, ce qui a entraîné une chute de près de 50 % des effectifs. Antoine Jaquenoud, lui, pointe du doigt une autre faille : « L’armée manque de 12’000 hommes et déclare inapte trop de conscrits. Certains, comme moi, ont été recalés par la médecine militaire ». Face caméra, il explique que son initiative permettrait à la Protection civile d’exister « comme une milice indépendante de l’armée », avec ses propres critères et missions, tout en incluant tous les profils, y compris les femmes.
Liberté, contrainte et engagement
Le cœur du débat réside dans la notion d’obligation. « L’obligation de servir existe déjà », rappelle Antoine Jaquenoud. « Mais aujourd’hui, beaucoup ne peuvent s’engager qu’en passant par l’armée, et les femmes doivent écrire deux courriers pour être éventuellement admises dans la Protection civile ou le service civil. »
L’initiative ouvrirait ces portes à toutes et tous, sans passer par le filtre militaire. « Chacun pourrait choisir sa milice et cela serait une forme d’égalité réelle entre les genres », estime-t-il.
Dans sa réaction, Jean-Marc Chevallaz nuance : « Pour moi, le service citoyen doit rester un choix personnel et non une contrainte ». Il redoute qu’un système obligatoire ne vide le mot « citoyen » de son sens. « L’engagement doit venir du cœur, pas de la loi. On peut apprendre la solidarité, mais on ne peut pas l’imposer ». Avec ses expériences à la PC, il rappelle les réalités du terrain : « Beaucoup de jeunes font leur service uniquement pour éviter de devoir payer la taxe d’exemption. Ce n’est pas un moteur durable. »
Des incitations plutôt qu’une obligation ?
Le président de la Protection civile Lavaux-Oron plaide pour une approche plus incitative : « Il faut donner envie de s’engager. Cela passe par la valorisation des missions, une meilleure reconnaissance et des conditions adaptées aux jeunes et aux employeurs. » Jean-Marc Chevallaz évoque aussi le manque de moyens : « On nous demande de plus en plus de missions sans nous donner les effectifs nécessaires. Le risque, avec cette initiative, c’est de rajouter de la complexité administrative sans améliorer la situation »
Dans le camp du oui, Antoine Jaquenoud y voit au contraire un levier de modernisation : « Notre société a changé. L’obligation de servir permettrait de garantir un engagement équilibré entre les générations et les sexes. Les milices existent déjà, pompiers, colonnes de secours, sans que cela pose problème. Nous proposons simplement d’en faire un pilier civique reconnu. »
Une question de cohésion nationale
Hors caméra, les deux interlocuteurs s’accordent sur un point : la nécessité du débat : « Le Parlement n’a pas proposé de contre-projet, alors que le texte soulève de vraies questions », reconnaît Jean-Marc Chevallaz. Pour Antoine Jaquenoud, la promotion de l’initiative sur le terrain démontre une chose : « Même nos opposants le disent, notre initiative oblige à réfléchir à la manière dont la Suisse conçoit l’engagement. »
En conclusion de ce débat vidéo, nous avons demandé aux deux invités de répondre en une phrase, pourquoi voter non, pourquoi voter oui ? Les deux politiques résument avec simplicité : « Il faut que l’engagement reste un choix, pas une contrainte », argumente Jean-Marc Chevallaz tandis qu’Antoine Jaquenoud répond : « qu’il faut donner les moyens de ce choix à toutes et à tous. »



