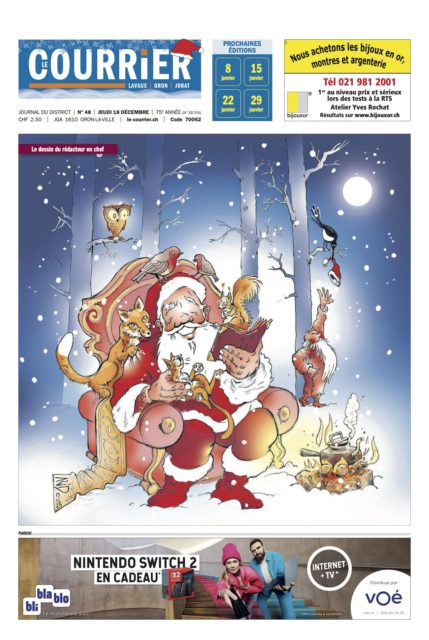La petite histoire des mots
Vaccin
Georges Pop | La polémique, parfois venimeuse, entre partisans et adversaires de la vaccination a été relancée la semaine dernière après la publication d’une étude menée pendant plus de dix ans auprès de 650’000 enfants danois, selon laquelle le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) n’augmente pas le risque d’autisme. Pour les défenseurs de la santé publique conventionnelle, il s’agit d’une démonstration irréfutable ; pour les adversaires, minoritaires il est vrai, un complot de plus ourdi par les laquais des grands groupes pharmaceutiques. Il serait stérile de s’immiscer ici dans cette virulente dispute. Aussi nous contenterons-nous présentement d’éplucher l’ascendance singulière du mot «vaccin» qui, dans son acception moderne, est né vers la fin du 18e siècle. En ce temps-là, les vaches souffraient d’une maladie relativement bénigne désignée en latin sous le nom de «variola vaccina» ou encore «vaccine», autrement dit «variole de la vache». La variole des humains, bien plus grave que celle du bétail, faisait alors des ravages chez les personnes infectées qu’elle finissait par défigurer cruellement. Mais curieusement, celles et ceux qui étaient en contact régulier avec les vaches atteintes de vaccine étaient presque totalement préservés de la maladie sous sa forme la plus sévère. Un dicton de l’époque affirmait d’ailleurs: «Si tu veux une femme qui n’aura jamais de cicatrice au visage, épouse une laitière». Constatant que les trayeuses ne tombaient presque jamais malade de la variole des humains, un médecin anglais du nom d’Edward Jenner – connu jusqu’alors pour ses observations sur la nidification des coucous – supposa que la vaccine des vaches les avait immunisées. En mai 1796, afin de valider sa théorie, il inocula à un gamin de huit ans le contenu des vésicules présentes sur la main de Sarah Nelmes, une paysanne qui avait contractée la vaccine en trayant une vache appelée Blossom (Fleur). Le jeune garçon souffrit bien d’une petite poussée de fièvre, mais il ne tomba jamais malade et le médecin en conclut que son jeune patient avait bel et bien été immunisé, sans comprendre cependant tous les tenants et aboutissants du processus. Deux ans plus tard, Edward Jenner utilisa en anglais le mot «vaccine» pour annoncer sa découverte et le terme fut rapidement adopté par le monde médical, y compris en France sous le nom de «vaccin» que nous lui connaissons de nos jours. Il fallut cependant attendre près d’un siècle pour que soit vraiment compris le principe d’action de la vaccination, grâce à Louis Pasteur. En mai 1885, le médecin français reçut un petit berger alsacien de 9 ans, qui avait été mordu par un chien enragé deux jours plus tôt. Le garçon ne présentait encore aucun symptôme de la maladie et Pasteur hésita à lui inoculer son vaccin expérimental. Finalement, l’enfant reçut en l’espace de dix jours 13 piqûres du virus atténué de la rage, contenant chaque fois une souche de plus en plus virulente. Le petit berger ne développa jamais la maladie. Louis Pasteur est aujourd’hui considéré comme le père de la vaccination. Il eut cependant de nombreux précurseurs, dont Edward Jenner que l’histoire qualifie d’inventeur, non pas de la vaccination, mais de l’immunologie. Et le génial médecin anglais reste aussi le père incontesté du mot «vaccin».