La petite histoire des mots
Obésité
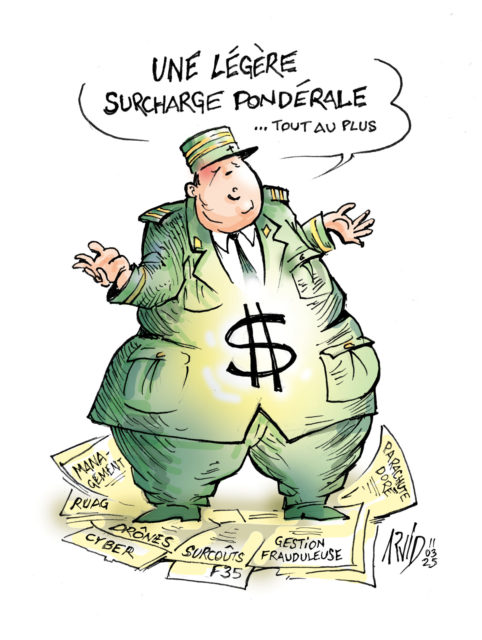
Dans un rapport publié la semaine dernière dans la revue scientifique de référence The Lancet, un groupe de chercheurs lance un cri d’alarme : selon ces scientifiques, sans une action forte et immédiate des gouvernements, une épidémie mondiale de surpoids et d’obésité touchera six adultes sur dix et un enfant et adolescent sur trois d’ici à 2050. Tous les pays sont concernés.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’obésité comme une maladie chronique non transmissible, le plus souvent handicapante, caractérisée par une accumulation excessive de graisse corporelle pouvant nuire à la santé. Toujours selon l’OMS, 35 % des adultes sont déjà, aujourd’hui, en situation d’obésité dans le monde, y compris dans de nombreux pays émergents.
Le mot « obésité » est, semble-t-il, discrètement apparu dans notre langue au XVe siècle, dans un ouvrage de médecine intitulé « Methode Chirurgicale chapitre des esprits ». Il s’agit d’un des rares livres de médecine de la Renaissance rédigés en français, et non en latin, écrit par un médecin rouennais du nom de Hervé Fierabras. L’auteur, qui y évoque « un excès d’embonpoint », a manifestement emprunté ce terme au latin « obesitas », dérivé de « obsesus » (gros, replet, bien nourri), qui désignait déjà chez les Romains le ventre d’une personne trop grasse.
A une époque où les famines faisaient des ravages, l’obésité était considérée comme un signe de richesse, de puissance, et même de santé. Cette vision de l’obésité perdura tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ce n’est qu’au XVIIe siècle que la médecine commença à y voir une atteinte à la santé. La grosseur devient alors, progressivement, synonyme de lourdeur, lenteur, pesanteur, et même paresse.
Les mots « obésité » et « obèse » ne s’imposèrent vraiment dans le langage, et dans les dictionnaires, qu’au XIXe siècle. Dans son livre « Les métamorphoses du gras », l’historien français Georges Vigarello explique que le regard devint alors plus critique, en brocardant le bourgeois obèse avec son ventre protubérant et son aspect en poire. Le gastronome et auteur culinaire Jean Anthelme Brillat-Savarin fut le premier à parler d’ « obésité abdominale », dont il qualifia ironiquement les porteurs de « gastrophores », un néologisme associant les mots grecs « gaster » (ventre) et « phoros » (porteur).
Pour faire face à l’épidémie d’obésité qui menace l’humanité, les chercheurs proposent aujourd’hui toute une série de mesures : réglementer la publicité des aliments ultra-transformés, intégrer des infrastructures sportives et des terrains de jeux dans les écoles, encourager l’allaitement maternel et les régimes alimentaires équilibrés et développer des politiques de nutrition saines, etc.
Avec tout le respect qui est dû aux personnes qui souffrent de cette maladie, terminons par un sourire, et cette citation anonyme un brin méchante : « Obèse, né sous le signe de la balance ! »



