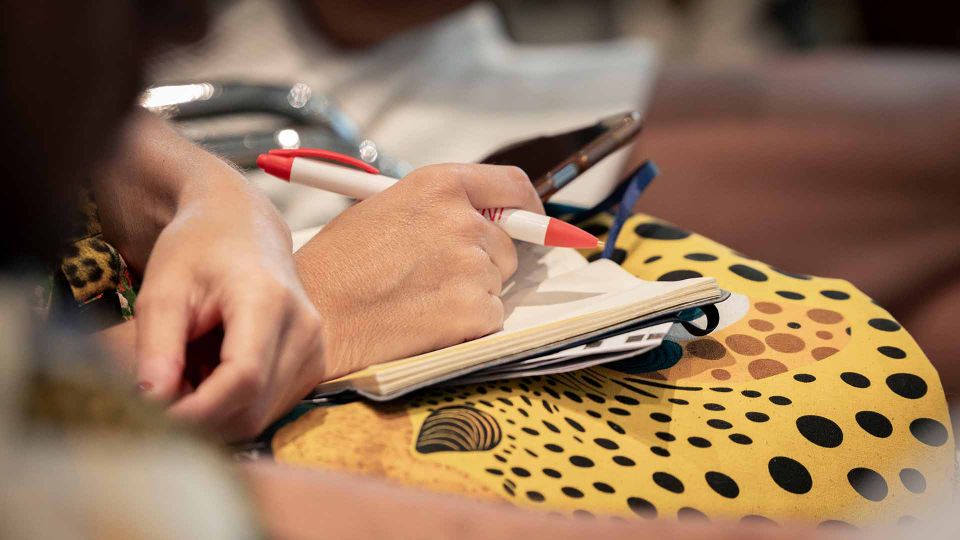Cinéma – A Locarno, la Critics Academy comme une tour de Babel solide
En 2019, ma participation au festival du film de Locarno a été marquée par ma rencontre avec Colette Ramsauer, qui m’a progressivement ouvert la voie vers cette rubrique. Six ans plus tard, ce même événement a été synonyme pour moi de nouveaux horizons pour mon métier, par le biais de la Critics Academy.
Olivia J. Bennett, Charlyne Genoud, José Emilio González Calvillo, Bandamlak Y. Jemberie, Botagoz Koilybayeva, Jason Tan Liwag, Saffron Maeve, Olivia Popp, Cátia Rodrigues, Sonya Vseliubska : dix critiques réuni·e·s par Christopher Small, Chloe Lizotte et Daniela Hanusová pour dix jours d’atelier qui interrogeait ce qu’est être critique de film aujourd’hui. Venant des quatre coins du monde, chaque personne y représentait un pays. Jour après jour, une question nous rassemblait autour d’une grande table ovale en compagnie d’invité·e·s issu·e·s de la critique internationale. Comment travailler avec un·e éditeur·ice, que dire en sortant d’une séance, quel rapport entretiennent les réalisateurs·ices à la critique, comment bien mener une interview ? Au fil des discussions, une vision riche sur l’écriture critique s’est dessinée : l’importance, par exemple, dans le cadre d’un compte rendu de festival, de voir la programmation comme une sorte d’état des lieux du monde présent, et de parvenir à restituer cela avec un point de vue singulier. En échangeant sur ce qui rend un écrit intéressant, nous parlions en creux de la raison d’être d’un métier menacé.
Un festival de film est un lieu d’effervescence, à la fois par la quantité de films qui y sont projetés, et par la présence de milliers de personnes qui consacrent à l’année leur vie au cinéma, et qui se retrouvent dans une même ville pour courir d’une salle à l’autre. Cette grande fourmilière est marquée par des arythmies multiples : on court, pour mieux s’arrêter pendant trois heures devant Dry Leaf (Alexandre Koberidze, 2025) par exemple. Les fenêtres sur le monde s’ouvrent au fil des rencontres et des projections, mais aussi au fil des conversations de couloir ou des malentendus linguistiques.
Au bord du lac Majeur, mes collègues et moi avons tenté une drôle d’expérience : celle de parler chacun·e dans notre langue maternelle, quelques minutes durant. Si l’on ne se comprenait plus vraiment, l’énergie collective continuait de circuler. Dans le mythe de Babel, Dieu disperse les hommes aux quatre coins de la terre et leur fait parler des langues différentes pour les empêcher de bâtir un édifice qui atteindrait le ciel. Ici, pourtant, la confusion n’était pas un obstacle mais une force, une manière d’affirmer nos voix plurielles.
Un festival de film international ressemble à une tour de Babel : les films sont des éclats précis de réalités venues des quatre coins du monde. Dans les salles de cinéma de Locarno se superposent dix jours durant des centaines de langues. Ode aux sous-titres : pour peu que l’on parle anglais, français ou italien, la barrière linguistique s’efface. Le festival crée une communauté éphémère et variée, faite de personnes ayant vu les mêmes images et entendu les mêmes voix sans y lire la même chose. Ce groupe qui se crée par la traversée d’histoires et de mots partagés se retrouve dans la magnifique initiative qu’est la Critics Academy. Amenés à habiter tous ensemble avec nos collègues des Filmmakers et Industry Academy, les liens du groupe se resserrent au fil des discussions professionnelles, des articles communément écrits, et des rencontres à trois heures du matin dans la salle de bain partagée. L’anglais qui nous unit est troué d’accents et de formulations bancales – parfois drôles, parfois sources de malentendus (surtout dans mon cas) : il s’agit ici d’apprendre à se traduire autant qu’à décoder un nouveau lexique. Réuni·e·s par une langue que chacun·e accentue à sa sauce, exprimant par-là d’où l’on vient et qui l’on est, nous parvenons en dix jours à construire une tour de Babel qui est ici un édifice solide : la redécouverte de nos pratiques critiques, par le prisme d’un point de vue international. La critique n’est alors plus uniquement un métier ou une pratique solitaire, mais un espace de rencontre, d’échange et de réinvention collective.