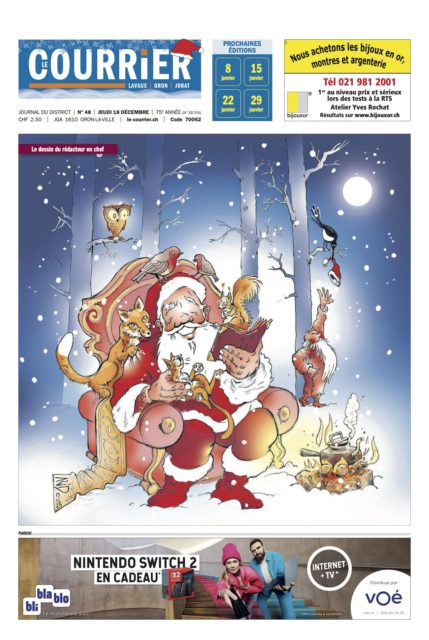C’est à lire
Une extraordinaire fresque romanesque du XXe siècle
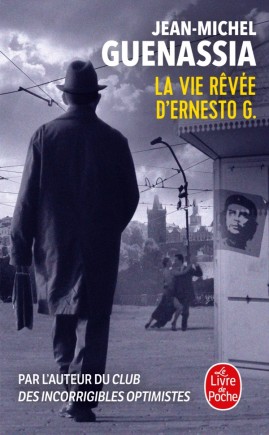
Le roman de Jean-Michel Guenassia, La vie rêvée d’Ernesto G., publié en 2012, n’est pas tout récent, mais il n’a pas pris une ride. Il est accessible maintenant en collection de poche.
Le personnage principal, autour duquel vont graviter de nombreux autres, est Joseph Kaplan, Juif de Prague. Il va faire ses études de médecine à Paris. C’est la fête, mais aussi un labeur assidu dans le prestigieux Institut Pasteur. Il est engagé dans l’antenne d’Alger de ce laboratoire. Évocation d’Alger-la-Blanche très réussie. L’auteur la connaît bien, car il y est né en 1950. On remarquera que les « indigènes » en sont quasi absents. Il ne faut pas y voir une attitude colonialiste, car le propre frère de Guenassia a été tué pour l’Indépendance, après avoir gagné le maquis aux côtés du FLN. Mais en 1940, c’est la débâcle de la France, et les lois antisémites de Vichy sont strictement appliquées en Algérie. Les Juifs sont privés de la nationalité française, arrêtés et enfermés dans des camps insalubres. Joseph échappe à ce destin, grâce à un emploi de chercheur et médecin dans une région particulièrement inhospitalière, où il est confronté à l’extrême misère des Arabes d’Algérie. Quand survient la Libération en 1945, il décide de retourner dans sa ville natale.
Toute la seconde partie du roman se situe donc à Prague. On assiste à l’euphorie initiale de nombreux Tchèques, persuadés que le communisme apportera le bonheur. Mais dès 1948, le ciel s’assombrit rapidement et une dictature stalinienne s’installe. Elle culmine avec les pendaisons du début des années cinquante, notamment après le « procès Slansky », dont le livre L’Aveu d’Arthur London (porté à l’écran par Costa-Gavras avec l’acteur Yves Montand) donne une image terrifiante.
En 1966, Joseph Kaplan reçoit l’ordre de s’occuper, dans un sanatorium de province, d’un unique patient, un certain Sud-Américain dont le pseudonyme est Ramon Benitez. On comprend bien vite qu’il s’agit du célèbre Ernesto Che Guevara, incognito et barbe rasée, rentré paludique de son équipée révolutionnaire complètement ratée au Congo. Le Che semble bien revenu de ses illusions et porte un regard sans complaisance sur le communisme bureaucratique à la soviétique. Là se greffe une histoire d’amour (il y en a plusieurs dans le roman) avec Helena, la fille de Joseph. L’auteur émet l’hypothèse, discutable mais pas impossible, que le révolutionnaire aurait songé à changer complètement de vie. Cependant, la politique le rattrape. Et cet amour finira brutalement, dans des circonstances que le lecteur découvrira. Un an plus tard, en 1967, le Che sera sommairement exécuté par l’armée bolivienne qui l’avait acculé dans la jungle, lui et ses quelques compagnons en perdition. On vivra aussi le Printemps de Prague et la brutale invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie en 1968. Beaucoup de Tchèques décident alors de fuir le pays. Joseph Kaplan choisit de rester. Il connaîtra encore la « Révolution de velours » de 1989 et le retour à la démocratie. Le livre se termine en 2010, alors qu’il a atteint ses cent ans.
Cela dit, il ne s’agit pas d’un austère livre d’histoire. C’est une véritable fresque romanesque dont la lecture est passionnante, avec de nombreux personnages et des péripéties crédibles qui relancent l’intérêt du lecteur. Ne craignez donc pas la longueur de ce texte ! Tout cela sur fond des fameux tangos chantés par l’Argentin Carlos Gardel, disparu trop tôt en 1935 dans un accident d’avion.
L’auteur a aussi écrit un précédent livre qui a connu un immense succès, Le club des incorrigibles optimistes. Celui-ci le mérite tout autant.
« La vie rêvée d’Ernesto G. » de Jean-Michel Guenassia
Le Livre de Poche, 2022, 571 p.