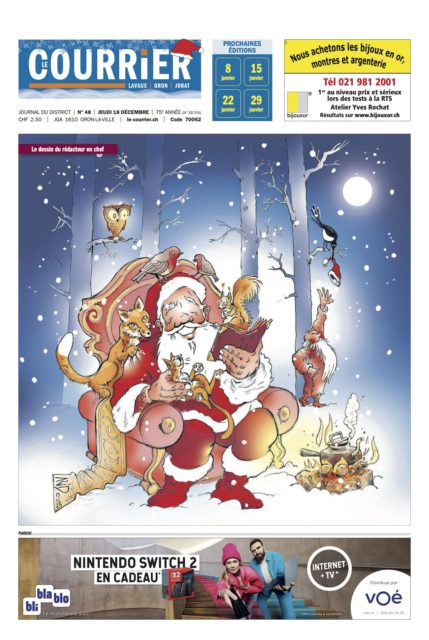Votations populaires
Le 30 novembre 2025, la Suisse s’exprimera sur deux initiatives populaires qui entendent, chacune à leur manière, remodeler une part importante du pacte social. La première veut que tous les citoyens s’engagent au service du pays, la seconde demande davantage de moyens pour la politique climatique. Explications.
Pour une Suisse qui s’engage
Aujourd’hui, l’obligation de servir concerne uniquement les hommes. Ceux qui n’endossent pas l’uniforme militaire ou celui de la protection civile s’acquittent d’une taxe d’exemption. L’initiative « Service citoyen » souhaite étendre ce principe à l’ensemble des personnes de nationalité suisse, femmes et hommes. L’idée des initiants est de passer du fusil à la pelle, du casque militaire au casque de chantier, en deux mots, de repenser l’engagement de milice.

Elargir le spectre de l’engagement de milice
Concrètement, le texte propose que chaque citoyenne et chaque citoyen consacrent un temps déterminé à une activité d’utilité publique. Cela pourrait se faire dans l’armée, le service civil, la protection civile, mais aussi dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, le climat, la santé, l’assistance sociale ou encore la culture. En d’autres termes, l’objectif est d’ancrer dans la Constitution une obligation de servir qui dépasse le cadre militaire et renforce la solidarité nationale.
Pour les initiants, issus notamment de l’association « Association Service Citoyen », soutenue par de jeunes membres du Parti du Centre, du PLR et des Verts libéraux, il s’agit de moderniser un modèle vieux de plus d’un siècle. Leur argument : « Nous voulons une Suisse où chacun contribue à la communauté, selon ses compétences et ses convictions ». Cette initiative permettrait selon eux de renforcer la cohésion du pays, de redonner du sens à l’engagement collectif et d’offrir une réponse concrète à la pénurie de volontaires dans les institutions de milice comme l’armée ou le service civil.
Servir oui, mais comment ?
Le projet soulève de nombreuses questions pratiques. Comment organiser un service obligatoire pour l’ensemble de la population ? Qui déciderait des affectations ? Et surtout, combien cela coûterait-il ? Selon les estimations du Conseil fédéral, l’introduction d’un tel système entraînerait une charge considérable pour la Confédération, les cantons et les entreprises. Environ quatre fois plus de personnes seraient concernées qu’aujourd’hui, sans garantie que l’économie ou les structures publiques puissent absorber cet afflux.
Le gouvernement et le Parlement recommandent donc de rejeter l’initiative. Dans leur message, ils rappellent que le système actuel fonctionne : l’armée couvre les besoins en matière de défense, tandis que la protection civile intervient lors de catastrophes naturelles, de crises ou d’événements majeurs. Etendre l’obligation de servir à toute la population reviendrait, selon eux, à créer une bureaucratie lourde, coûteuse et difficile à gérer. Le Conseil fédéral souligne également que la Suisse dispose déjà de multiples formes d’engagement volontaire, notamment dans les associations, les services de secours, les pompiers ou la politique communale. Plutôt que d’imposer un cadre constitutionnel rigide, le gouvernement préfère encourager le bénévolat et reconnaître la valeur de l’engagement civil existant.
Les arguments pour et contre
Les opposants craignent aussi que cette réforme dilue la mission première de l’armée. En élargissant le champ du service à des activités civiles ou environnementales, on risquerait selon eux de perdre de vue la finalité de la défense nationale, pilier historique du service obligatoire. Certains estiment par ailleurs que cette réforme ferait peser une charge disproportionnée sur les jeunes générations, déjà confrontées à des contraintes économiques et sociales importantes.
Les partisans, au contraire, jugent cette évolution nécessaire. Ils rappellent que le service militaire ne concerne plus qu’une minorité de jeunes hommes et que la taxe d’exemption ne suffit pas à compenser cette inégalité. A leurs yeux, le service citoyen permettrait d’impliquer l’ensemble de la population, sans distinction de genre, et de valoriser des engagements aussi variés que l’aide aux aînés, la gestion de catastrophes naturelles ou la protection de la biodiversité.
Pour eux, la Suisse ne peut plus se contenter d’un modèle centré sur la défense : « Elle doit s’adapter aux nouveaux défis du XXIe siècle, climatiques, sociaux et économiques, en redéfinissant ce que signifie servir son pays ». L’introduction d’un service citoyen obligatoire constituerait ainsi, selon les initiants, une réponse moderne à l’érosion de l’esprit de milice et au recul de la participation civique.
Une question de vision de la société
Au fond, le débat dépasse la seule question du service. Il touche à notre conception du civisme : le sens de la solidarité, la place de l’Etat, la responsabilité individuelle dans la collectivité. Faut-il rendre obligatoire l’engagement pour créer du lien ? Ou au contraire, faire confiance à la volonté de chacun ? Le 30 novembre, les Suisses devront se prononcer. Derrière ce bulletin, il ne s’agit pas seulement de savoir qui doit porter l’uniforme, mais bien de déterminer comment chacun peut contribuer au bien commun dans la Suisse de demain.
Taxer les riches pour financer l’écologie
L’autre objet soumis au vote du 30 novembre entend lui aussi « moderniser » la Suisse, mais sur un tout autre terrain : celui du climat et de la justice fiscale. Intitulée « Initiative pour l’avenir », cette proposition veut instaurer un impôt fédéral sur les grandes successions pour renforcer le financement de la politique climatique. Si les initiants souhaitent une contribution accrue des plus fortunés, le Conseil fédéral et le Parlement restent sceptiques quant à son efficacité.

De nouvelles recettes pour la politique climatique
Nous devons prendre l’argent là où il est : chez les plus riches. Avec ces milliards, nous pourrons financer la transition sociale et écologique de la société », a déclaré Julien Berthod, vice-président de la Jeunesse socialiste suisse lors de la conférence de presse du 9 octobre de présentation.
Concrètement, le texte demande l’instauration d’un impôt fédéral unique sur les héritages et donations dépassant 50 millions de francs. La part inférieure à ce montant resterait exonérée. Au-delà, la moitié du patrimoine transmis serait prélevée par la Confédération. Les recettes seraient ensuite réparties par deux tiers pour la Confédération et un tiers pour les cantons, afin de financer des programmes en faveur du climat pour ramener les émissions de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050, comme en a décidé le peuple le 18 juin 2023.
Selon le comité d’initiative, baptisé « Pour l’avenir », cette réforme permettrait de dégager plusieurs milliards de francs par an (+6 mia). Ces fonds seraient investis dans la transition énergétique, la rénovation des bâtiments, la mobilité durable, la formation et l’innovation. Les initiants affirment que la Suisse doit désormais se doter d’un instrument de financement solide pour atteindre la neutralité carbone d’ici 25 ans, le tout, en garantissant que l’effort soit équitablement réparti.
« Nous voulons une politique climatique qui ne pèse pas sur ceux qui ont le moins », expliquent les porteurs de l’initiative. Selon eux, l’impôt proposé ne concernerait qu’un millier de personnes dans tout le pays. Néanmoins, l’Administration fédérale des contributions mentionne qu’environ 2500 ménages disposent d’une fortune supérieure à 50 millions de francs. Les auteurs de l’initiative souhaitent que les successions et donations dépassant ce seuil soient imposées dès l’entrée en vigueur du texte, en cas d’acceptation par le peuple.
Texte controversé
Pour le Conseil fédéral et le Parlement, la pilule est difficile à avaler. Tous deux recommandent de rejeter l’initiative, qu’ils jugent excessive et économiquement risquée. D’abord, parce qu’elle remet en question la répartition actuelle des compétences fiscales entre la Confédération et les cantons. « Le réchauffement climatique est l’un des grands défis de notre temps. Le Conseil fédéral partage donc l’objectif global de l’initiative (…), mais une politique climatique n’existe pas sans financement. Celui-ci doit être stable, sans fragiliser l’attractivité du pays ni les recettes fiscales. Il doit aussi respecter l’équilibre institutionnel, en particulier le fédéralisme, qui laisse aux cantons leurs rôles et leur autonomie », a déclaré la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter lors d’une conférence de presse le 13 octobre dernier.
Ensuite, le risque de fuite de capitaux. Les contribuables les plus aisés pourraient « quitter la Suisse, ce qui mettrait en danger des emplois et conduirait même à une baisse des recettes fiscales plutôt qu’à une hausse. L’initiative pourrait provoquer des pertes estimées entre 200 millions et 3.6 milliards », mentionne l’administration fédérale. Ce dernier met également en garde contre la complexité administrative d’un tel impôt, difficile à appliquer pour des fortunes souvent réparties dans plusieurs pays.
Enfin, le gouvernement rappelle que la politique climatique dispose déjà de moyens conséquents (près de 2 milliards de francs par an) issus des taxes sur le CO₂, des programmes d’efficience énergétique et du Fonds pour le climat adopté en 2023. Il juge donc inutile d’introduire un nouvel impôt, préférant renforcer les instruments existants et miser sur l’innovation technologique.