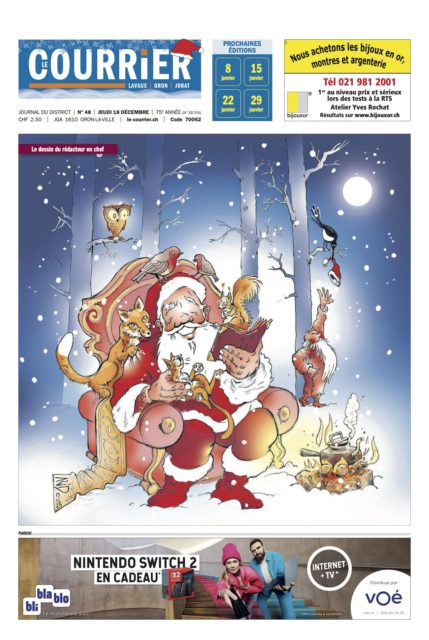La petite histoire des mots
Poulpe

Georges Pop | Celles et ceux qui ont pu voir le film « La sagesse de la pieuvre » ont très certainement été touchés par cette rencontre entre un plongeur et un « gentil » céphalopode. Le film raconte une histoire d’amitié entre un humain et un poulpe. Il a valu au réalisateur sud-africain Craig Foster l’Oscar du meilleur documentaire, même si les scientifiques soulignent qu’un poulpe, bien que très intelligent, n’est pas vraiment capable de s’attacher à un être humain : lorsqu’il tend ses tentacules vers son visiteur, il le fait davantage pour identifier une éventuelle proie que pour dire « bonjour ». Le mot « poulpe » nous vient du latin « polypus », emprunté au grec « polypous » qui associe les mots « poly » qui signifie « plusieurs » et « poús » qui veut dire « pied ». En français, le terme est avéré sous la forme « poulpre » dès le milieu du XVIe siècle, notamment sous la plume de Rabelais dans « Le Tiers livre des faits et dits Héroïques du noble Pantagruel ». Le terme latin nous a d’ailleurs donné aussi le mot « polype » qui, en zoologie, désigne certains animaux marins, tels les méduses, puis, en médecine, une tumeur bénigne, se développant sur les muqueuses, notamment intestinales. Le mot « pieuvre » est, quant à lui, d’origine beaucoup plus récente : il a été emprunté, par Victor Hugo, au dialecte des pêcheurs de Guernesey, lors de son séjour sur cette île anglo-normande. En 1866, il introduisit le mot « pieuvre » dans son roman « Les Travailleurs de la mer ». Le succès de l’œuvre fut tel, que « pieuvre » finit par supplanter « poulpe » dans la langue française et même en italien qui adopta très vite le mot « piovra ». « Poulpe » et « pieuvre » sont deux mots qui désignent le même céphalopode, minuscule ou géant, reconnu pour ses huit tentacules et ses ventouses, son mode de propulsion « à réaction », ainsi que sa capacité à changer instantanément de couleur pour se fondre à son environnement et échapper à ses prédateurs. Notons au passage que le mot « céphalopode », qui associe les termes grecs « képhalé » (tête) et « podos », le génitif de « pous » (pied), apparut dès 1798 dans le « Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des animaux », rédigé par l’anatomiste français Georges Cuvier, précurseur de l’anatomie comparée et de la paléontologie. Au figuré, de nos jours, le mot « pieuvre » désigne aussi une personne insatiable, sans scrupules, tenace dans ses exigences, qui accapare tout, ou une entreprise tentaculaire qui absorbe avidement ses concurrents. En Sicile, la pieuvre est ainsi devenue le symbole de la mafia, en raison de son immense réseau tentaculaire. Ce symbole est d’autant plus approprié lorsque l’on sait que la pieuvre peut régénérer ses tentacules lorsqu’elle en perd une ou plusieurs. La mafia fonctionne à l’identique : elle survit même lorsque la justice supprime une partie de son réseau. Elle est capable de créer de nouveaux réseaux mafieux. En guise de conclusion, relevons que dans de nombreux pays, notamment méditerranéens et asiatiques, le poulpe est un mets fort apprécié. Il peut être grillé à la poêle ou à la plancha, poché, cuit à la vapeur, en papillote au barbecue ou au four. Il faut bien constater que les humains sont infiniment plus voraces que ce brave céphalopode…